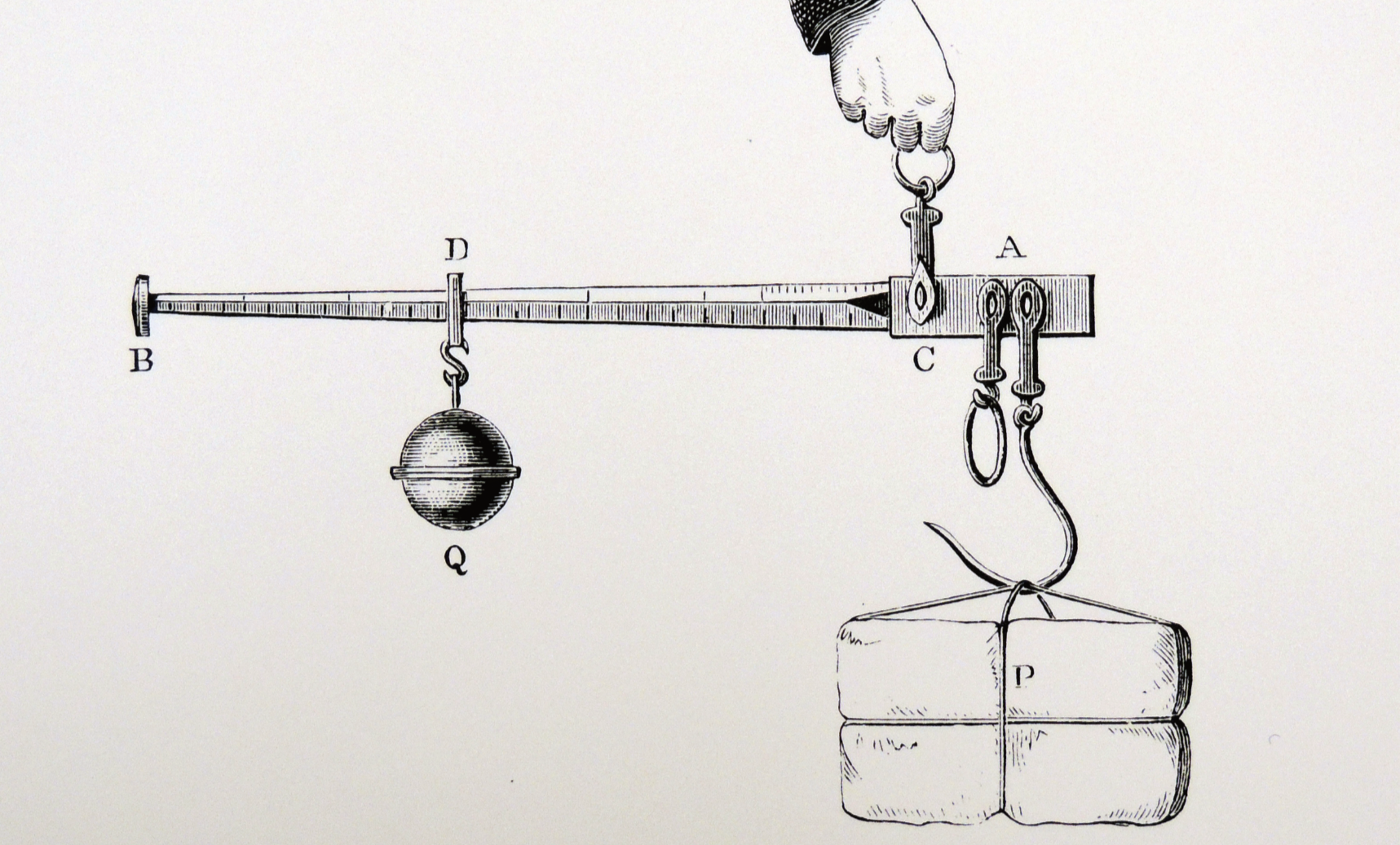Finance et transition : une équation impossible ?
Pour qui travaille sur les sujets de finance responsable depuis longtemps, la période actuelle pourrait sembler légèrement déprimante.
Les économistes libéraux traditionnels concentrés sur le risque et le profit et, de façon plus générale, ceux qui critiquent l’accent mis sur les enjeux sociaux et environnementaux dans le débat public remettent en cause la possibilité même de voir la finance contribuer aux enjeux de transition. L’objet de cette tribune est de mettre en perspective cette notion de finance responsable, qui est fort ancienne, et de juger de son avenir au-delà des polémiques du moment.
La finance responsable, une centenaire
Cette finance “responsable” n’est pourtant pas un pur phénomène de mode. Cela fait plus d’un siècle maintenant qu’elle est apparue dans l’économie de façon significative (d’autres initiatives sont en fait encore plus anciennes) avec les prises de position de grandes congrégations religieuses anglo-saxonnes, peu après la première guerre mondiale, sur la nécessité d’intégrer des valeurs morales dans ses choix financiers. Ces congrégations très puissantes disposaient d’importants portefeuilles d’investissement à gérer et il n’était pas question pour elles de consacrer leur argent à des « industries du péché » (alcool, jeu, pornographie, armement, tabac…). Cela a donné lieu aux premières grandes stratégies de finance responsable basées sur un principe d’exclusion. Ces exclusions, d’abord religieuses, sont par la suite devenues aussi politiques, dans les années 1960 et 1970 (rejet d’entreprises contribuant à la guerre au Vietnam ou au régime de l’apartheid en Afrique du Sud, par exemple), puis, plus récemment, environnementales (rejet du charbon…).
Jusqu’au début des années 2000, ces pratiques financières étaient réelles, mais assez limitées en masse, avec à peine quelques pourcents des actifs sous gestion. Il n’était pas rare alors qu’évoquer cette finance vous fasse directement ranger dans les catégories “curés”, “gauchistes” ou “théoriciens hors sol” – en particulier pour les enseignants-chercheurs qui s’y intéressaient… – la “vraie finance” ne pouvant bien sûr mettre au cœur de ces pratiques des critères autres que le risque et la rentabilité.
Le tournant des années 2000
La situation a complètement changé avec la prise de conscience du changement climatique et quelques événements marquants (accident du Rana Plazza, scandales de corruption ou émissions considérables de carbone dues à l’exploitation des sables bitumineux, par exemple). Il est apparu que la finance avait un rôle majeur à jouer pour financer des activités favorisant la transition, rejeter celles qui pouvaient être très polluantes ou, de façon générale, répondre aux attentes de détenteurs d’épargne – particuliers ou institutionnels – sensibles aux performances ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) de leurs investissements.
L’explosion de cette finance a été favorisée au cours des années 2000 par de nombreux travaux de recherche académique, qui ont montré qu’il était possible d’améliorer les performances ESG sans forcément détruire la performance financière. Si on travaille sur les opérations industrielles ou de service, ou sur les processus d’innovation, c’est assez évident, car l’expérience montre que quand on cherche à améliorer sa performance environnementale ou sociale, on trouve très souvent de nombreux gisements d’optimisation des coûts, d’amélioration de la qualité, de développement des affaires, etc. En revanche, si l’on regarde les choses avec le prisme de la théorie financière classique, cela ne va pas de soi. Cette possible combinaison des performances financières et des performances ESG, associée notamment à la montée en puissance du débat sur le risque climat avec les différentes COP, a ouvert de nombreux chakras et conduit les actifs sous gestion se prétendant responsables à représenter aujourd’hui d’un tiers à la moitié du total des actifs sous gestion, soit des milliers de milliards d’euros d’actifs au niveau mondial (les chiffres sont toujours à prendre avec la plus grande prudence). L’apothéose a été la période Covid, lorsque les fonds ISR (investissement socialement responsable) ont surperformé par rapport à quasiment tous les autres, mais pour une raison particulière en réalité : du fait de l’application de critères ESG, ils ont tendance à être largement surpondérés en titres des secteurs Santé et Technologies de l’information, qui ont particulièrement prospéré avec la pandémie.
L’impact de la guerre en Ukraine
Depuis l’éclatement de la guerre en Ukraine, l’explosion des coûts de l’énergie et le retour en grâce de secteurs peu goûtés par ces fonds ISR, comme le pétrole ou l’armement, ont eu l’effet inverse. De nombreux responsables financiers ou politiques expliquent que la finance responsable est en fait irresponsable – elle ne soutient pas la défense des démocraties et elle a une vision “idéaliste” du secteur énergétique – et a en plus des performances financières plutôt mauvaises par rapport aux financements de l’énergie fossile, par exemple. Si vous ajoutez à cela un cocktail de politique américaine avec les accusations de “wokisme” qui fleurissent notamment dans le camp républicain et certains États contre les fonds responsables, les ingrédients d’une remise en cause profonde du concept même de finance responsable sont réunis.
Alors, la finance peut-elle finalement jouer un rôle positif dans la transition ? Plusieurs éléments de réponse peuvent contribuer au débat.
La finance peut-elle favoriser la transition malgré tout ?
Tout d’abord, il n’est pas sûr que nous ayons vraiment le choix. L’endettement des États – singulièrement, celui de la France avec ses 3 000 milliards de dette publique – limite considérablement leurs marges de manœuvre. Les quelques dizaines de milliards d’euros annuels nécessaires à un pays comme la France pour financer les plans de transition envisagés doivent aussi venir des investisseurs privés. La bonne nouvelle est qu’à l’échelle des montants disponibles (les actifs globaux sous gestion en France sont de l’ordre de 4 500 milliards d’euros), cela ne paraît pas impossible. Toute la finance n’a pas forcément besoin d’être responsable, au sens où elle pourrait justifier l’application stricte et rigoureuse de critères ESG : si une partie l’est réellement, cela suffit. Et les acteurs financiers (banques, assurances, gérants d’actifs…) qui prétendent faire de la finance verte avec des produits qui ne le sont pas vraiment, justifiant ainsi les critiques de greenwashing, devraient alors être sanctionnés, notamment par les régulateurs des marchés (AMF, ACPR).
Il n’y a pas une finance, mais des finances responsables. Cette distinction renvoie à un débat qui agite beaucoup, depuis quelques années, les scènes européennes et américaines autour de la notion de matérialité, simple ou double selon les cas. Dit simplement, la simple matérialité est ce qui intéresse les financiers anglo-saxons, c’est la prise en compte des effets environnementaux ou sociaux externes sur le business model de l’entreprise. Les données ESG ont de la valeur en ce qu’elles permettent de mieux anticiper les risques et transformations de business model à engager. La double matérialité est ce qui domine en Europe continentale et consiste à intégrer, au-delà de la simple matérialité, les effets que l’entreprise peut avoir sur son environnement et à considérer qu’elle doit donc aussi rendre des comptes sur ses externalités. C’est une distinction fondamentale qui explique beaucoup les débats actuels : dans le premier cas, on considère que l’entreprise doit respecter les règlementations – qui doivent être fixées par des institutions externes, d’où le poids, aux États-Unis, des lobbys qui cherchent à influencer, voire capturer ce processus règlementaire – et maximiser sa valeur sous contrainte. Dans le second cas, tout en respectant bien sûr également les règlementations, l’entreprise est jugée responsable de ses effets positifs ou négatifs sur l’environnement et doit donc rendre des comptes au-delà de sa création de valeur financière classique. Ainsi, dans le premier cas, si la performance ESG ne “paie pas”, ce n’est pas à l’entreprise de la réaliser, d’où les accusations de wokisme et d’interférences gauchistes des tenants de cette performance par les penseurs libéraux les plus classiques. Dans les modèles de gouvernance où d’autres parties prenantes que les seuls actionnaires jouent un rôle important, cette vision très financière choque… mais ne pousse pas pour autant les investisseurs eux-mêmes à accompagner les projets de transition. C’est un peu l’ambiguïté clé dans laquelle nous sommes, particulièrement en France : accuser la finance de tous les maux, attendre d’elle qu’elle fasse à la fois de la performance ESG en tant que citoyen et de la performance financière en tant qu’épargnant.
Comme souvent, le diable est dans les détails
Comme on l’a vu, la recherche a montré que c’était possible, mais l’analyse de la vie des organisations montre sans cesse que le diable est dans les détails. Il faut cependant éviter que cela devienne infernal avec, par exemple, comme on le voit aujourd’hui, des exigences de reporting ou une explosion des règlementations qui rendent la prise en compte de ces enjeux ESG extrêmement complexe et coûteuse.
C’est donc sur ces diables de détails que les éclairages de l’École de Paris sont indispensables. Au-delà des incantations, montrer comment créer simultanément de la valeur financière et de la valeur ESG sur des terrains très concrets, et expliquer pourquoi c’est difficile et quels rôles les différents acteurs peuvent jouer est absolument indispensable. C’est par ces nombreux détours à partir d’exemples souvent lumineux que l’on finira peut-être par trouver les clés d’une articulation fructueuse entre finance et transition. Car, au-delà des grands discours macroéconomiques, nos séminaires prouvent que, par ces terrains concrets, un profond renouvellement est en train de s’opérer.
Alors équation insoluble ? Pas sûr en fait…