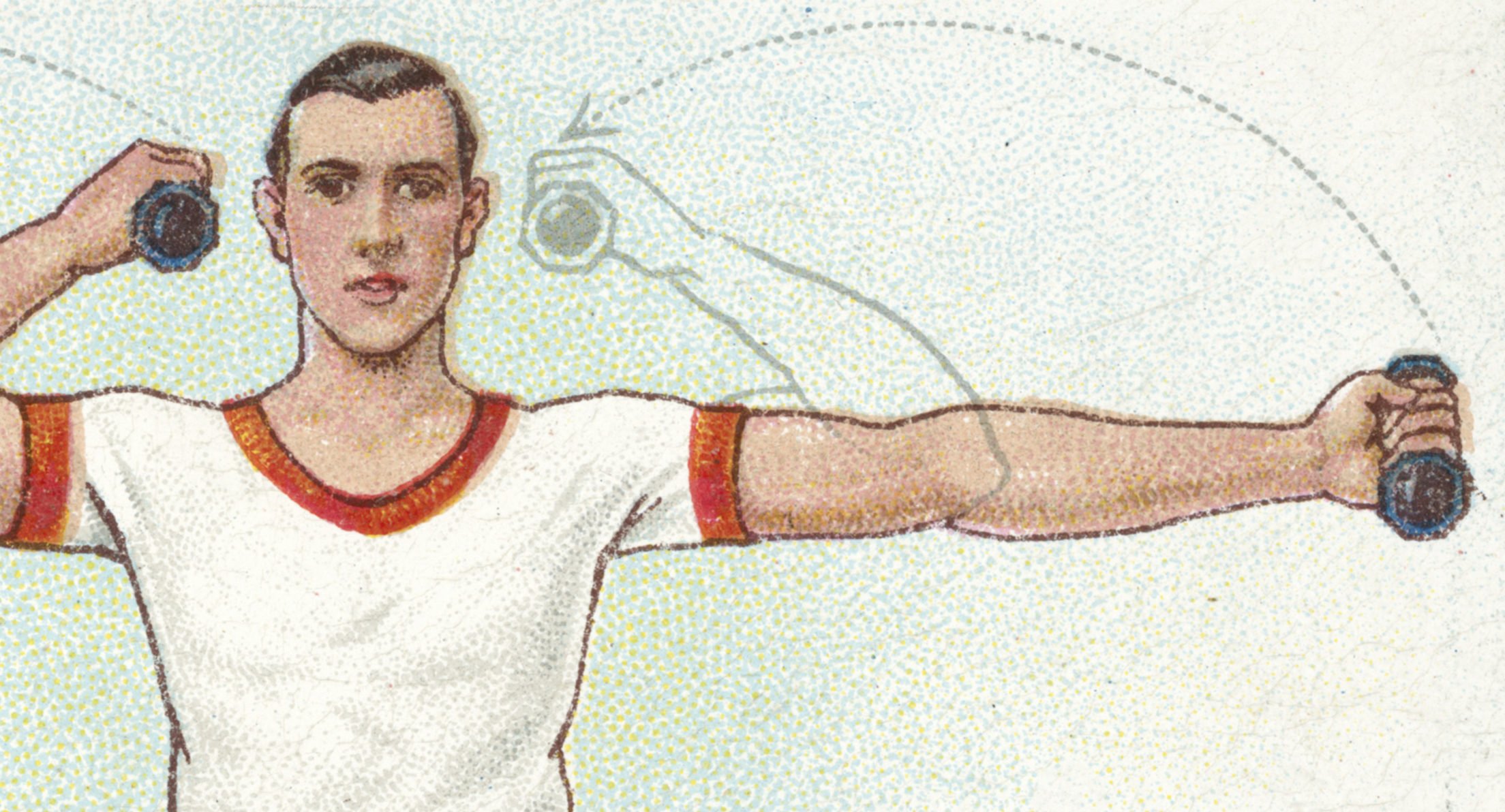Au service des arts décoratifs depuis plusieurs siècles, le Mobilier national conserve 140 000 objets et entretient 7 ateliers de restauration. Dès 1964, il s’est doté de l’Atelier de Recherche et de Création pour offrir aux designers français un espace d’expérimentation et à la filière, une fonction de R&D. Aujourd’hui, il entend se positionner sur les enjeux de réindustrialisation et de transition écologique, et jouer un rôle d’accélérateur de l’entrepreneuriat et de la structuration d’une filière design haut de gamme pour tous.
Exposé de Marc Bayard
Depuis le Moyen Âge, la tradition du garde-meuble est liée à l’itinérance du roi qui, jusqu’à son installation à Versailles, voyageait de château en château. Institué au XVIIe siècle par Colbert, le Mobilier national, aujourd’hui garde-meuble de la République, continue de s’occuper de l’ameublement des palais de l’État. Né de cette tradition et symbole du savoir-vivre français, le Mobilier national s’appuie sur son passé pour penser son avenir : un interventionnisme d’État dans le domaine des arts décoratifs.
S’inscrire dans une histoire séculaire
Nos collections, parmi les plus importantes du monde, comptent environ 140 000 objets et sont suivies par 7 inspecteurs-conservateurs. Elles servent au dépôt en institutions publiques et politiques, mais aussi en musées, à des fins de décoration et de valorisation. Grâce à nos 7 ateliers, nous pouvons restaurer la quasi-totalité de ces collections, qui requièrent des savoir-faire d’exception parfois très anciens. Dans nos ateliers de tapisserie d’ameublement et de siège, nous sommes, par exemple, en mesure de restaurer des meubles selon une technique du XVIIIe, qui consiste à créer des rembourrages à base de crin de cheval sculpté à l’aiguille. Nous avons aussi des ateliers de tapisserie de décors pour les apparats de textile ; d’autres dédiés au bois, pour l’ébénisterie en volume ou à plat ; et enfin, un atelier lustrerie-bronzier, qui traite spécifiquement les dorures de carcasse des éléments mécaniques, des lustres aux horloges. Toutefois, il n’est pas question de seulement conserver le passé. Notre mission n’est pas de maintenir les objets dans un état ancien à des fins de patrimonialisation, mais de créer de l’usage en s’adaptant au présent. C’est la raison pour laquelle nous sommes au fait des techniques les plus modernes, mobilisées pour participer à l’évolution d’un objet et garantir son utilité.
Le Mobilier national, en tant que restaurateur et producteur, est donc avant tout destiné à faire de la création contemporaine autour d’objets d’usage, et ce depuis quatre siècles ! Cela le rend unique, aucune institution de garde-meuble n’ayant d’équivalent de cette alliance entre temporalité, patrimoine et création. Nos manufactures historiques illustrent cela. Celle des Gobelins, dans le 13e arrondissement de Paris, a été fondée en 1440 pour teindre la laine, selon notre propre nuancier. Nous sommes ainsi passés, depuis le XVIIe siècle, de 300 à 16 000 teintes, conçues et fabriquées dans nos laboratoires, dédiés à l’élaboration de couleurs susceptibles de durer des siècles. La manufacture des Gobelins est l’un des témoins de cette emprise territoriale historique, peut-être banale pour un auditeur français, mais fascinante pour les étrangers ! Elle est, par ailleurs, dédiée à la haute lisse, technique propre à la tapisserie royale, qui n’est jamais mise en vente. Cette tradition liée au destinataire de l’œuvre justifie encore que, de nos jours, une tonture de tapisserie réalisée pour une famille royale soit produite aux Gobelins. La manufacture de Beauvais, née à la fin du XVIIe siècle, se caractérise par un tissage dit en basse lisse, et produit des tapisseries murales et d’assise mises sur le marché. La Savonnerie, mise en activité sous Henri IV et installée au pied de la colline de Chaillot sous Louis XIII, fabrique des tapis de velours d’après la technique turque du nœud gordien. Nous comptons également deux ateliers de dentelle, au Puy et à Alençon. Ils sont spécialisés dans les techniques du fuseau et de l’aiguille, cette dernière étant inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Aujourd’hui, seules 3 ou 4 dentellières au monde perpétuent ce savoir-faire d’une extrême méticulosité : elles ne peuvent travailler que trois heures par jour, pour quelques millimètres d’ouvrage. Enfin, nous faisons de la création de mobilier autour d’un atelier de recherche et développement, fondé dans les années 1960, sous l’égide d’André Malraux. Né de la prise de conscience de l’insuffisance des investissements d’État pour l’innovation dans le domaine du design, il est au service des créateurs et des industriels.
Un colbertisme 4.0 ?
Au croisement de considérations esthétiques, idéologiques et politiques
La définition des arts décoratifs, en France, relève de deux foyers artistiques majeurs. Le premier, issu du XVIIIesiècle italien, tient à l’émergence de la perspective et au creusement mathématique de l’espace, qui permet de projeter de la profondeur sur une surface plane. Le second, plus ancien et spécifiquement français, est l’art des cathédrales. Il est, quant à lui, celui du décoratif et de la tridimensionnalité. Entrer dans une cathédrale, c’est entrer dans un espace où la lumière parle aux vitraux, qui eux-mêmes résonnent avec les ornements ecclésiastiques, les tapisseries, les émaux, etc. Le spectateur, présent dans l’œuvre, en est acteur. Cette émergence, à la période gothique, transcende les époques avec des acmés spectaculaires au XVIIe ou avec l’art de l’ensemblier, chef d’orchestre de cette tridimensionnalité dans les lieux de vie. Elle fait du design, à savoir cette pensée d’un rapport entre forme et fonction, une invention française. Enfin, nous sommes les seuls, en France, à avoir 22 styles décoratifs, qui plus est ramifiés en sous-catégories variées.
Pourtant, une autre particularité spécifiquement française tient à la déconsidération des métiers de la main. Elle remonte sans doute à l’Antiquité, qui distingue les arts majeurs des arts mineurs, et se réaffirme chez nous au XVIIIe, lors de la séparation de l’École des beaux-arts de l’École des arts décoratifs. Cela institue une coupure entre pensée et réalisation d’un geste que l’on aurait dû envisager dans sa continuité. À cela s’ajoutent des choix stratégiques, issus de notre histoire nationale. Durant l’après-guerre, dans le contexte de la reconstruction, la France s’est orientée vers un modèle quantitatif de moyenne gamme, rapidement concurrencé par les pays émergents. D’autres, comme l’Allemagne ou l’Italie, se sont positionnés sur du haut-de-gamme, prenant le tournant de la recherche et de l’innovation vers l’excellence. Nous avons ainsi partiellement détruit un tissu industriel qu’il faut aujourd’hui remodeler, qui plus est avec un retard sur nos voisins. C’est l’ambition du Mobilier national dans le secteur des arts décoratifs.
Vous ne pouvez pas lire la suite de cet article