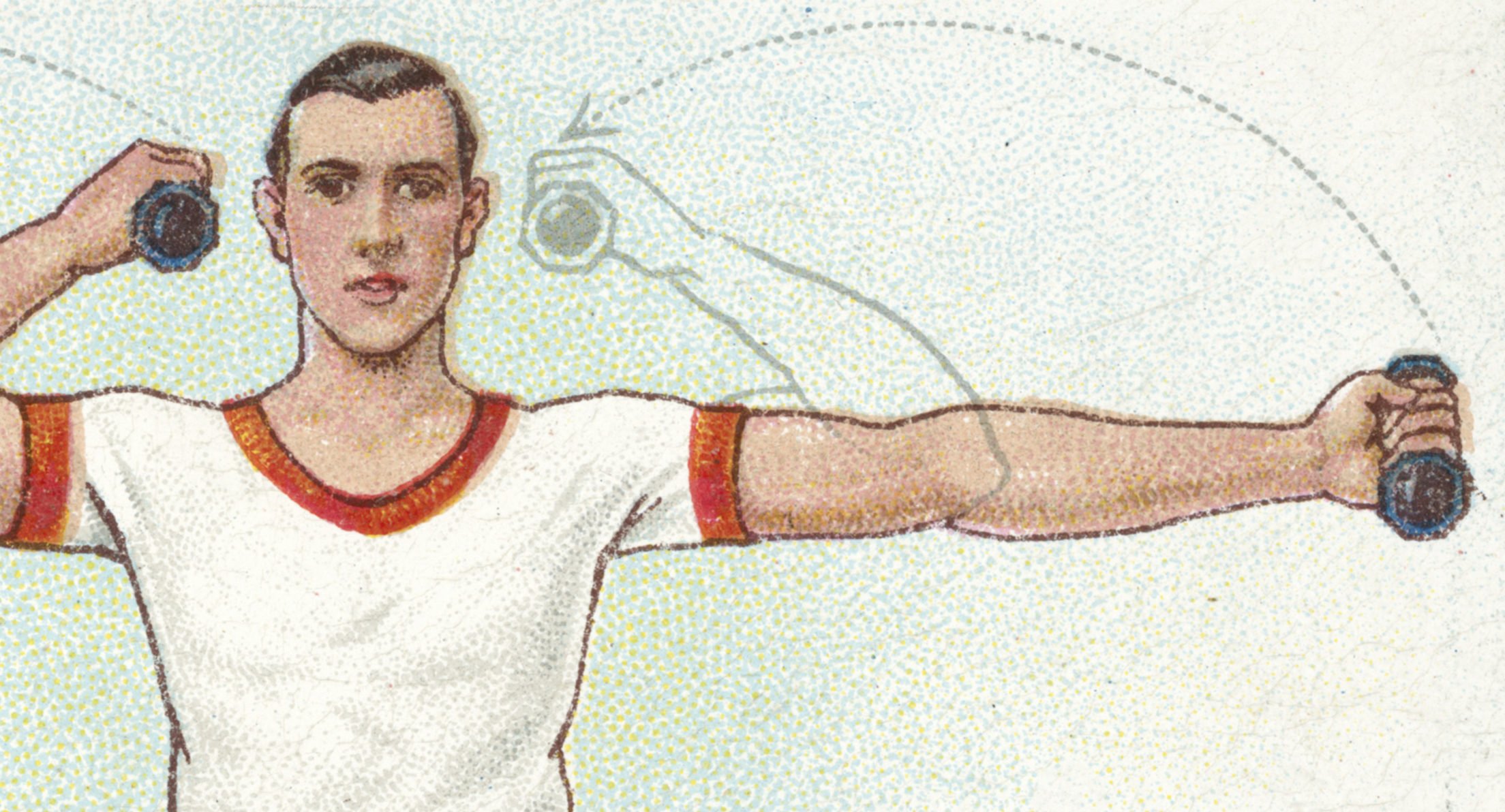- Une démarche audacieuse
- Les entreprises concernées
- Le processus
- Des informations soumises à des normes
- Une approche différente de l’analyse comptable
- Trois grandes interrogations
- Les préparatifs
- L’élaboration du rapport
- Une inquiétude
- Le métier d’Amundi
- Un axe prioritaire en Europe
- L’extraterritorialité
- La mobilisation des comex
- Les ressources humaines
- Le recours à l’estimation
- L’audit des données
- La mesure de l’impact sur la biodiversité
- Le rôle des contre-pouvoirs
- Vers une standardisation au niveau mondial ?
- Faciliter les prévisions à moyen terme
Selon l’idée que ce qui ne se mesure pas n’est pas pris en compte dans les stratégies des entreprises, de nouveaux indicateurs sont aujourd’hui proposés pour intégrer les enjeux de la transition écologique. Cependant, les nouvelles exigences réglementaires européennes sont-elles raisonnables ou disproportionnées ? Que sait-on vraiment mesurer ? Sur quelles décisions les informations ESG peuvent-elles influer ? Le reporting de durabilité sera-t-il une opportunité pour les entreprises vertueuses ou une nouvelle corvée bureaucratique ?
Exposé de Chrystelle Richard
En préambule, je souhaite préciser que je m’exprime aujourd’hui en mon nom personnel et que mes propos n’engagent ni l’ANC (Autorité des normes comptables) ni l’IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board).
Une démarche audacieuse
La CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) a été adoptée en 2022 par l’Union européenne et transposée en droit français en 2023. Elle est applicable depuis le 1er janvier 2024. L’objectif est d’améliorer la disponibilité et la qualité des informations de durabilité, également appelées informations ESG (environnementales, sociales et de gouvernance), et d’harmoniser les rapports de durabilité. Avec cette directive, l’Union européenne cherche à réduire le greenwashing et à contraindre les entreprises à une plus grande transparence sur la façon dont elles opèrent leur transition écologique.
La CSRD s’inscrit dans la longue histoire du reporting extrafinancier. Celle-ci a commencé en 2001, avec la loi NRE (Nouvelles régulations économiques), suivie, en 2010, de la loi Grenelle 2, puis de la transposition, en 2014, de la directive européenne NFRD (Non Financial Reporting Directive), qui a imposé aux grandes entreprises françaises de publier leur DPEF (déclaration de performance extrafinancière) à partir de 2017.
La CSRD s’avère toutefois plus audacieuse et courageuse que les lois précédentes. Elle impose, en effet, de prendre en compte à la fois l’impact du changement climatique sur la profitabilité de l’entreprise (matérialité financière) et l’impact de l’activité de l’entreprise sur son environnement (matérialité d’impact). Cette double matérialité doit pousser les entreprises à adapter réellement leur modèle d’affaires à la transition écologique. La CSRD vise ainsi à préserver leur profitabilité et leur viabilité dans le respect des limites planétaires.
Les entreprises concernées
Les controverses suscitées par cette démarche viennent non seulement de ce caractère très ambitieux, mais aussi du fait que, à terme, le nombre d’entreprises concernées en Europe sera bien plus important que pour la précédente directive, passant ainsi de 11 700 à 50 000.
Vous ne pouvez pas lire la suite de cet article