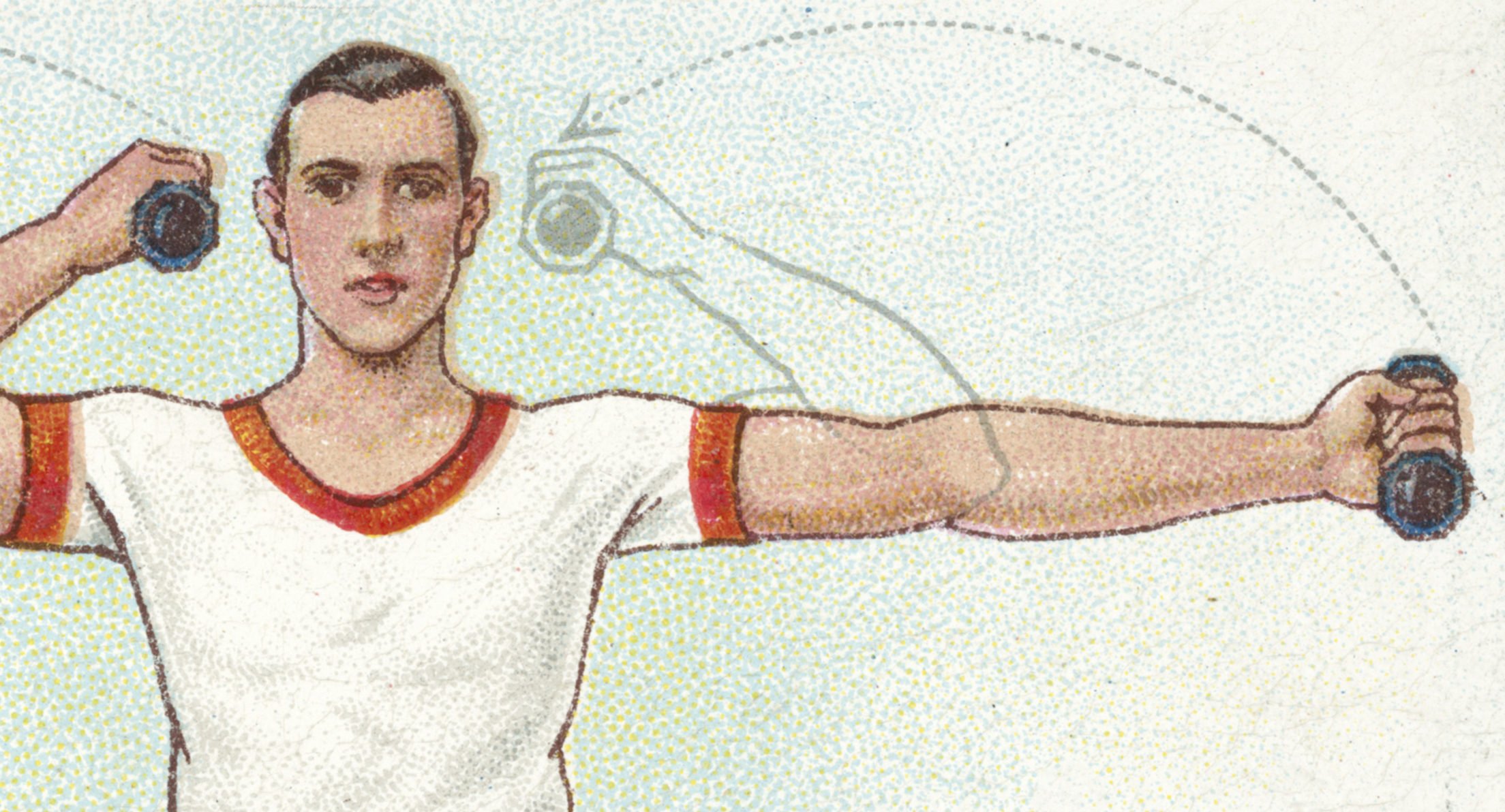- L’économie circulaire au Québec
- La méthodologie des laboratoires d’accélération en économie circulaire
- Le Lab construction
- Les résultats
- Le transfert vers les acteurs de la construction
- Les retombées pour les participants
- L’importance d’une approche systémique
- Les perspectives
- Le BIM
- Maintenir l’enthousiasme
- L’émergence des projets
- Les promoteurs immobiliers
- L’articulation du bâtiment à son quartier
- La question des assurances
- Le rôle des chercheurs, des acteurs de terrain et du législateur
- Faire des émules
- L’application de la méthodologie à d’autres secteurs
- La valeur ajoutée du Lab construction
La construction, responsable de plus de 40% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, est un secteur économique majeur au Québec. Grâce aux financements du gouvernement québécois et du Mouvement Desjardins, le CERIEC œuvre pour en accélérer la transition circulaire. Il a créé le Lab construction, un dispositif de recherche et d’expérimentation qui a rassemblé, dans des ateliers, plus de 300 acteurs de la construction et des chercheurs, et a cocréé et financé 19 projets autour de pratiques circulaires.
Exposé d’Alice Rabisse
Depuis deux ans, je coordonne, avec ma collègue Hortense Montoux, un dispositif appelé Lab construction, qui vise à accélérer la transition circulaire du secteur de la construction au Québec. Ce dispositif a été initié par le CERIEC (Centre d’études et de recherches intersectorielles en économie circulaire), un des centres de recherche d’une des écoles d’ingénieurs de Montréal, l’ÉTS (École de technologie supérieure).
Le CERIEC a été fondé en septembre 2020 pour contribuer au déploiement de l’économie circulaire au Québec à travers un programme de recherche scientifique interdisciplinaire, des programmes d’enseignement et de formation, et enfin des initiatives de dialogue, de valorisation et de transfert destinées à accroître les retombées des avancées scientifiques pour les acteurs économiques, les gouvernements et la société civile.
Le CERIEC fédère des chercheurs de toutes les universités québécoises francophones et anglophones relevant de nombreuses disciplines (ingénierie, mais également sciences économiques, architecture, sciences de l’environnement, biologie, etc.).
L’économie circulaire au Québec
Notre planète est actuellement confrontée à une triple crise : le réchauffement climatique, qui atteint déjà 1,5 degrés Celsius ; la menace d’extinction d’1 million d’espèces vivantes ; l’épuisement des ressources naturelles, en raison de l’extraction et de la transformation de 100 milliards de tonnes de matières premières par an. Cette crise est, entre autres, liée au modèle de l’économie linéaire, selon lequel les matières extraites sont transformées en produits qui sont distribués, utilisés, puis jetés, ce qui génère du gaspillage, de la pollution et des déchets tout au long de la chaîne.
À ce modèle s’oppose celui de l’économie circulaire, définie par le Pôle québécois de concertation sur l’économie circulaire comme « un système de production, d’échange et de consommation visant à optimiser l’utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un service, dans une logique circulaire, tout en réduisant l’empreinte environnementale et en contribuant au bien-être des individus et des collectivités ».
L’économie circulaire suppose, en amont, de repenser les produits et services afin de réduire la consommation de ressources et de préserver les écosystèmes (écoconception, consommation et approvisionnement responsables, optimisation des opérations…), puis, en aval, d’utiliser les produits plus fréquemment (économie collaborative, location court terme…), de prolonger la durée de vie des produits et de leurs composants (entretien et réparation, don et revente, reconditionnement, économie de la fonctionnalité…), et, enfin, de donner une nouvelle vie aux ressources (écologie industrielle, recyclage et compostage, valorisation…).
L’indice de circularité du Québec n’est que de 3,5 %, ce qui signifie que seulement 3,5 % des matières introduites dans notre économie y sont réintégrées en fin de vie des produits. L’indice circulaire mondial était de 7,2 % en 2023 et il a atteint 24,5 % en 2020 aux Pays-Bas, champions mondiaux dans ce domaine.
Vous ne pouvez pas lire la suite de cet article