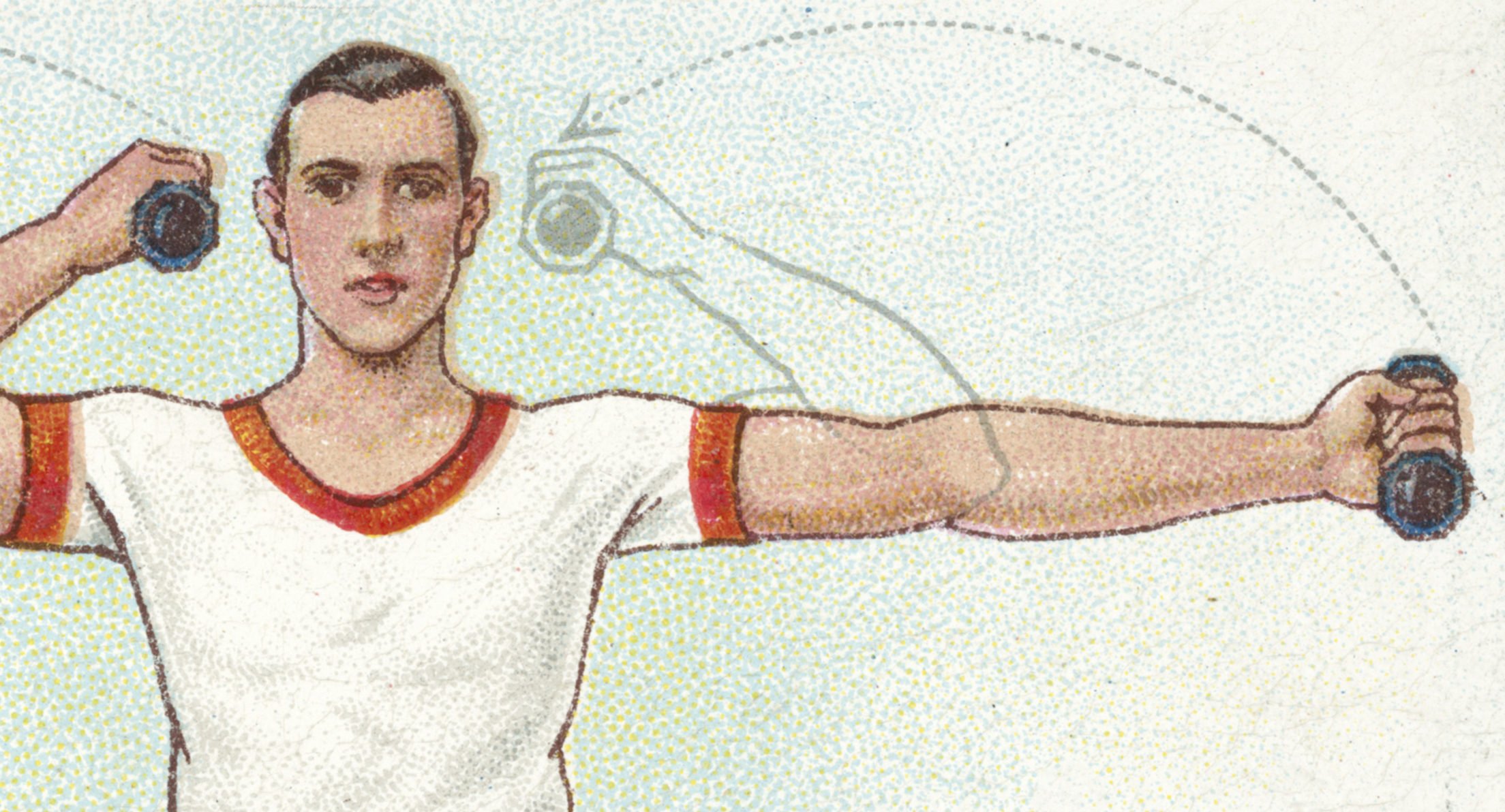- Le tableau actuel
- La méthanisation
- Biométhane : un faisceau d’intérêts
- La filière biométhane en France
- GRDF, un acteur-pivot de cette filière
- Une transformation réussie
- Les relations avec le monde agricole
- Les enjeux de la biomasse
- Les coproduits de la méthanisation : digestat, CO₂ biogénique…
- Stockage et biométhane non-injecté
- Une filière en plein essor
- GRDF, ses ambitions, ses moyens
Quasi-nulle en 2013, la production du biométhane a représenté 12 TWh en 2023 et devrait atteindre 44 TWh en 2030. Ce succès est celui de toute une filière, mais aussi d’un acteur central. Comment GRDF a-t-il perçu le potentiel du biométhane et s’est réinventé pour contribuer à la décarbonation de l’économie ? Ce cas nous montre comment l’urgence climatique associée à une vision à long terme devient un formidable levier de mobilisation et comment des écosystèmes dynamiques et résilients peuvent se développer dans les territoires.
Exposé de Xavier Passemard
Je suis ingénieur agronome de formation, ce qui n’est pas anodin par rapport au sujet de cette séance, car le regard d’un agronome, d’un spécialiste du monde du vivant, est forcément un peu différent de celui d’un technologue. En biologie, il est courant d’avoir affaire à ce que j’appelle des “boîtes grises”, transformant des intrants en “extrants” sans que l’on ne comprenne exactement comment la boîte fonctionne… C’est un peu ce qui se passe avec le processus naturel à l’origine des biogaz. Après cette formation d’agronome, j’ai suivi un parcours assez peu conventionnel, qui m’a conduit à passer de la banque à l’immobilier, avant de rejoindre le nouveau groupe GDF Suez (aujourd’hui ENGIE), où j’ai travaillé dans le domaine des déchets, en France et à l’international. Il y a six ans, j’ai intégré GRDF, filiale d’ENGIE et principal distributeur de gaz naturel en France et en Europe.
L’aventure des gaz verts et du biométhane a démarré, chez GRDF, avant mon arrivée. L’honneur en revient à mes prédécesseurs, qui ont été assez visionnaires – ou assez fous – pour se lancer dans cette grande et belle aventure, à laquelle personne ne croyait au départ. Je vais vous exposer comment elle a été rendue possible et a été menée.
Le tableau actuel
Un mix énergétique encore principalement fossile…
Contrairement à ce que l’on entend parfois ici ou là, aujourd’hui, notre mix énergétique est encore principalement fossile. Si l’on détaille la composition des 1 532 térawattheures (TWh) de consommation finale (chiffres de 2022), le charbon (1 %), le pétrole (39 %) et le gaz naturel (18 %) en représentent à eux trois près de 60 %. Cette consommation finale est principalement tirée par les transports (34 %) et le résidentiel (28 %), suivis par l’industrie (18 %), le tertiaire (17 %) et, loin derrière, l’agriculture (3 %).
Comme vous le savez sans doute, l’ambition de la France est de ramener cette consommation finale aux alentours de 1 000 TWh à l’horizon 2050, en résorbant totalement la part des énergies fossiles. Cette transformation radicale est donc double. Le premier objectif passe par la poursuite et l’amplification de nos efforts en matière de sobriété (par exemple, le chauffage à 19 degrés Celsius des bureaux et bâtiments publics) et d’efficacité (par exemple, l’isolation thermique des bâtiments) énergétiques. Le second objectif passe par la substitution, aux énergies fossiles, d’autres formes d’énergie, qu’il s’agisse du nucléaire – dont on peut penser ce que l’on veut, mais qui a le mérite de produire une électricité bas carbone –, des énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque…), mais aussi, on l’oublie parfois, des gaz verts, au premier chef desquels le biométhane.
Le gaz a un énorme atout. Il est, en effet, indispensable pour assurer la “pointe de puissance” appelée de façon aléatoire au cours de l’hiver, quand les besoins de chauffage du secteur résidentiel sont les plus importants. Ce défi est plus difficile à relever avec les énergies renouvelables, par essence dépendantes des conditions d’ensoleillement ou de vent, et avec le nucléaire, même si des progrès constants dans le domaine des batteries améliorent peu à peu le stockage de l’électricité. Aujourd’hui, dans les faits, c’est le gaz qui nous permet de franchir cette pointe de puissance. Cette composante du mix énergétique lui apporte une souplesse essentielle.
Vous ne pouvez pas lire la suite de cet article